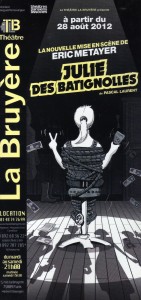« L’enfant », terrible drame rural

Pour imaginer cette création, Carole Thibaut s’est installée en résidence à Saint-Antoine l’Abbaye, commune de l’est de la France en 2009. Un village comme il en existe des milliers. A partir de témoignages reçus, elle crée son décor, une fiction où elle dénonce à quel point l’immobilisme des « honnêtes gens » (au sens auquel l’entendait Brassens), peut conduire aux pires horreurs. Ce texte est le premier volet d’un vaste projet baptisé « Les communautés territoires ».
L’Enfant – Drame rural part d’une métaphore biblique, celle de la destruction de Sodome (qui a été détruite, non pas pour le péché de sodomie qu’on y pratiquait comme il est courant de l’entendre, mais pour le mauvais traitement fait à des étrangers de passages, contrairement à la coutume antique de l’hospitalité). Ici, un enfant est abandonné de bon matin au pied de la ferme la plus isolée d’un village de l’Isère. Ses occupants (une idiote et son père) ne peuvent le garder et le confient au maire, qui le confie à sa sœur qui demande à sa femme de ménage d’en prendre soin. Au final, l’enfant se trouve à nouveau chez l’idiote, qui s’enfuira avec lui pour éviter qu’on ne le lui prenne de nouveau.
Tout au long de l’intrigue, on suit l’Enfant de main en main, le spectateur entre donc dans chaque foyer. Se retrouve du bon côté de la porte pour observer ce qu’il se déroule dans le salon des habitants, dans leur intimité, jusque dans les moindres détails du mobilier… Comment peuvent-ils être monstrueux au point de ne pouvoir garder un bébé quelques heures ? Finalement l’Enfant est prétexte à une fresque effroyable par sa vérité. On est effaré de ce que peut faire l’humain par égoïsme ordinaire. Et bien que ce thème paraisse évident, la façon dont il est montré est particulièrement étonnante.
De belles lumières, un dispositif scénographique ingénieux (qui ressemble à celui de « Ma chambre froide » de Pommerat) et une bande son nous plaçant dans un espace temps radicalement bouleversant font de ce drame un portrait qui semble terriblement réel. Monstrueusement réel. Sans pour autant tomber dans le réalisme gorgé de larmes et d’angoisses. Carole Thibaut a créé un monde dans l’écriture, elle arrive très bien à le faire rejaillir théâtralement, avec une pincée de cynisme grinçant bienvenue.
La création dure 2 h 15, et pourtant elle s’arrête au bon moment, à aucun instant cela ne semble long. Et elle réussit la prouesse de ne pas tomber dans la tragédie sanglante inutile. En choisissant de faire narrer la fin du drame à l’Enfant, elle ne se préoccupe pas de faire mourir chacun de ses personnages, elle se contente juste de nous montrer leur chute, leur vie en somme.
Les acteurs sont tous excellents dans ces rôles, bien marqués et, une fois de plus, tellement crédibles. Ce drame rural ne touche pas que ses protagonistes. Il est affreusement universel.
Pratique : Jusqu’au 27 octobre au théâtre la Tempête, La Cartoucherie de Vincennes, Route du Champ-de-Manoeuvre (75012, Paris) – Réservations par téléphone au 01 43 28 36 36 ou sur www.la-tempete.fr/ / Tarifs : entre 12 € (étudiants, chômeurs) et 18 € (plein tarif) – Du mardi au dimanche.
Durée : 2 h 15
Texte et mise en scène : Carole Thibaut
Avec : Marion Barché, Thierry Bosc, Eddie Chignara, Sophie Daull, Emmanuelle Grangé, Donatien Guillot, Fanny Santer, Boris Terral.
Tournée :
- Le 8 novembre, ATP de Millau
- Le 10 novembre, ATP de Dax
- Le 13 novembre, ATP d’Aix-en-Provence
- Le 14 novembre, ATP d’Avignon
- Le 16 novembre, ATP de l’Aude, Pennautier
- Le 20 novembre au théâtre Roger Barrat, Herblay
- Le 22 novembre, ATP d’Uzès
- Le 24 novembre, ATP de Nîmes
- Le 27 novembre, ATP d’Epinal
- Le 30 novembre à l’Apostrophe, Scène Nationale de Cergy-Pontoise
- Le 8 janvier, ATP d’Orléans
- Le 18 janvier, ATP de Roanne
- Le 22 janvier, ATP de Poitiers
- Le 1er février à la Ferme de Bel Ebat, Théâtre de Guyancourt
- Le 16 avril, ATP de Lunel
- Les 27 (ou 28) juillet au festival « Textes en l’air » de Saint-Antoine l’Abbaye