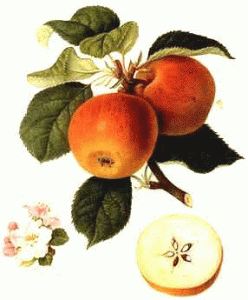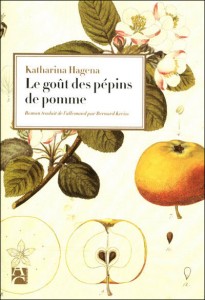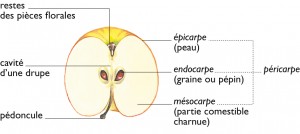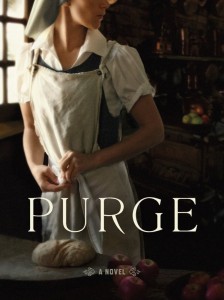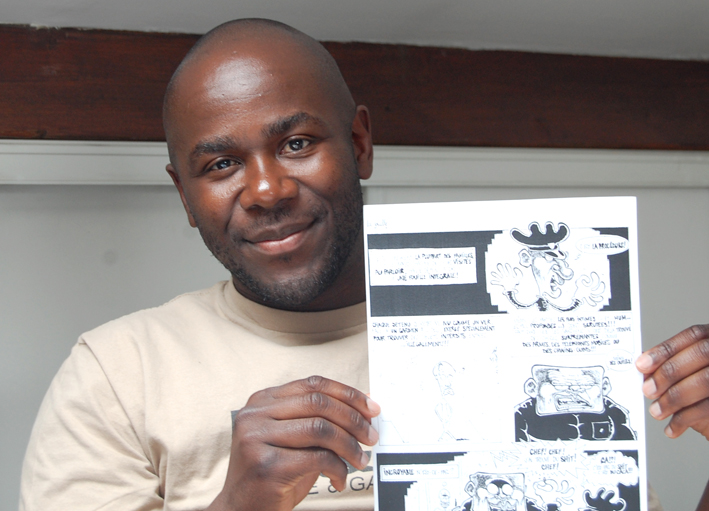« Frontières » sans limites à NAVA
Le festival NAVA (Nouveaux Auteurs dans la Vallée de l’Aude) est un monde dans un monde. Une poignée de pèlerins qui s’intéressent aux plumes du théâtre, présentes et futures, au milieu de nulle part, dans un de ces magnifiques paysages français.
À l’intérieur de la programmation 2011, il y a eu une œuvre qui sera considérée un jour comme « de jeunesse » d’un auteur résolument nouveau : Régis de Martrin-Donos, aujourd’hui âgé de 23 ans. Baptisée « Frontières », c’est la première mise en espace établie à partir de ce texte.
Quels mots ! Et quels comédiens !
Dans le cadre splendide du château de Serre, une chaise attend l’acteur. Le jour s’éteint peu à peu, et, entre chien et loup, le Fils (Sylvain Dieuaide) s’installe. La folie se lit dans son regard, une psychose évidente se confirme sur le visage dès les premiers mots de sa mère (Raphaëline Goupilleau), plutôt marâtre. Elle s’évertue à descendre son fils plus bas que terre, secouant la mémoire du grand frère modèle comme une cloche au-dessus du crâne de sa dernière progéniture tout en l’habillant des pieds à la tête. L’habillant de mots, l’habillant d’insultes, l’habillant pour l’hiver en somme.
« Plus je te regarde et plus tu es laid » lance-t-elle. Comme la mère d’H.P. Lovecraft à son fils. Quand on sait dans quelle folie ce rejet maternel a plongé l’écrivain, on ne peut pas se retenir d’imaginer le pire pour ce garçon qui évolue face à nous. Heureusement, il ne se laisse pas brimer sans réagir. On assiste à sa première rébellion envers celle qui l’a mis au monde. Il lui dit qu’il veut sortir, faire sa vie, savoir qui il est, partir à la Guerre.
La folie s’exprime enfin. Le Fils est un humain avec des airs de mutant, ou de zombie, aucune importance… Il arrive désormais à sortir le monstre que sa mère a enfanté avec lui.
Sylvain Dieuaide offre une interprétation juste, nous faisant par là-même oublier qu’il tient un texte en main. Lorsqu’on suit le fil de son parcours en 2011, il a joué dans « La Coupe et les Lèvres » d’Alfred de Musset mis en scène par Jean-Pierre Garnier, une œuvre collective où seul le groupe avait sa place, et le seul souvenir marquant que pouvait laisser le comédien était qu’il jouait du piano. Puis il a interprété Jean-Louis dans « Perthus » de Jean-Marie Besset, mis en scène par Gilbert Désveaux. Un rôle très bien incarné mais où il n’était pas le héros. Dans « Frontières », il est ce héros, il habite ce Fils, il est fou et nous emmène sans efforts dans sa folie transcendante.
Lorsqu’enfin, il s’échappe, c’est pour tomber sur le balai du gardien de l’immeuble (Yves Ferry), qui finit de dessiner ce monde rédhibitoire aux yeux du jeune homme. Une terre dévastée où la guerre entre Nord et Sud fait rage. « C’est trop tôt pour voir le monde » ou encore « Tu n’as pas le droit ! » lui serine-t-il. Cet échange (comme le reste de la pièce) est magnifiquement mis en espace par Benjamin Barou-Crossman, le gardien et le fils s’installant dans un jeu de chat perché dominant /dominé très esthétique.
Il s’avère au moment de partir que cet homme est le père que le Fils n’a jamais connu. C’est l’auteur qui prend un coup d’avance sur le spectateur en faisant se poser la question au personnage avant qu’elle n’arrive à notre esprit. Et cette brillante prise de court sur le public n’est qu’un petit rubis échappé de ce texte qui, entier, est couronné de joyaux.
La troisième scène représente le Fils complètement fanatique, ayant traversé des déserts entiers pour rejoindre le front à pied, il rencontre un déserteur (Stefan Delon). Cet homme le met face à ce qui habite souvent la jeunesse : la fougue, la naïveté, la sensation d’être invincible quand on sort enfin à la découverte du monde. Lorsque l’on s’évade « du rêve de ses parents », que se passe-t-il ?
Refusant de tuer le soldat, Le Fils repart et expérimente. Il tente de vivre la vie dont il rêvait, et finalement, se retrouve nez à nez avec sa mère, la Guerre est finie, mais il souffre de n’avoir pu se battre. Et c’est dans les derniers mots que naît l’évidence, avec une phrase particulièrement forte, d’un Fils aux ailes coupées adressée à celle qui l’a mutilé : « J’ai compris que mon seul ennemi c’était toi, je te déclare la guerre ».
Quand un jeune auteur met ces mots sur du papier, et que d’excellents comédiens les incarnent aux yeux d’un public unanime, on aurait tendance à s’interroger sur ce qui a poussé Régis de Martrin-Donos à écrire cela, à sa vie, à ses blessures. Mais lorsque l’on vit ce moment de théâtre intense dans un festival si singulier, alors on ne peut qu’imaginer le futur et ce qu’on pourra encore découvrir de cet écrivain à la plume si brillante. On ne sort pas du spectacle rassasié, non, on sort conquis et avide de découvrir la suite.
La seconde pièce de Régis de Martrin-Donos, « Un garçon sort de l’ombre » sera créée lors de la saison 2011-12 du CDN des Treize Vents à Montpellier du 27 octobre au 4 novembre. La mise en scène sera signée Jean-Marie Besset, et Stefan Delon y tiendra de nouveau l’affiche.
Plus d’informations : http://www.theatre–13vents.com