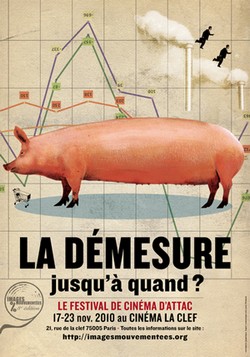Created with Admarket’s flickrSLiDR.
Imaginez-vous, une soirée fraîche d’automne. Le jaune et le rouge par petites tâches sur des feuilles encore vertes. Les corps qui s’affaissent sur les chaises après une journée de labeur. La mélodie légère du babillage, de table en table. Le cliquetis des cuillères sur les tasses de chocolat bien chaud. Paris animé. Paris gai.
Un café. Louis-Ronan Choisy en chair et en (m)ots – et en rires.
De la création artistique. Ses correspondances. La scène. Mais aussi la vie. Extraits.
De la création en général – Qu’est-ce qui déclenche en toi « le feu créateur » ? Une situation, un sentiment, des conditions particulières ?
Il y a plusieurs cas de figure.
Quand je ne sais pas quoi raconter, je regarde dans mes souvenirs. Repère ce qui peut être intéressant. A ce moment-là, tu fais vraiment un voyage spatio-temporel. Tu essaies alors de ressentir les choses que tu as ressenties au moment où tu les as vécues. Ca, c’est une première solution.
Ou par moments, tu es dépassé. Tu portes des choses trop lourdes. Tu as alors besoin d’écrire pour exorciser. Seulement, là, ça arrive souvent comme un gros dégueulis. Complètement informe. Mais c’est ce qu’il faut essayer de préserver. Ce côté un peu brut, instantané. Toute la difficulté, c’est de transférer ce sang-là dans une structure de chanson. Surtout que mes chansons, ce n’est pas de la musique expérimentale. C’est vraiment de la pop. Couplet-refrain, ça reste très classique.
Dans ton troisième album, les Enfants du Siècle, tu as pourtant recours à une méthode « expérimentale », le cut-up (NDLR : technique de Burroughs).
Oui, c’était voulu, oui.
J’avais envie d’expérimenter ça. Ca s’y prêtait bien. Les Enfants du Siècle, je l’ai écrit à une période où j’avais une grande peur de l’avenir, du monde qui se barre en couilles.
Je cherchais à créer quelque chose de plutôt déséquilibré. Toujours sur le fil. Techniquement, ça voulait dire associer des mots, d’un champ lexical, d’une sphère complètement différents.
Et c’est ce qui a été la trame de tout l’album.
Un cas bien particulier alors.
De toute façon, chaque album est particulier.
A chaque album, tu as une technique d’écriture différente. Sur le premier, c’était à partir de souvenirs. Le deuxième, je l’ai écrit en discothèque. Et là pour le coup, c’était vraiment de l’écriture automatique. Et sur le troisième, c’était semi-automatique. La démarche était pensée.
Et sur le dernier, Rivière de Plumes, comment as-tu travaillé ? Dans quelles conditions ?
Comme dans les Enfants…, c’était en home studio. Mais différemment. Sur les Enfants du siècle, j’ai travaillé avec un mec qui fait beaucoup d’électro (NDLR : Yann Cortella). On a d’abord travaillé en binôme. Ensuite, les musiciens sont arrivés pour apporter un peu d’organique à l’ensemble. Sur Rivière, j’ai travaillé avec mon guitariste, qui est aussi arrangeur sur l’album (NDLR : Frédéric Fuchs). On est parti d’une base guitare sèches-voix. Puis, j’ai ajouté des guitares électriques pour que ce soit un peu moins chiant. Après le tournage du Refuge, on a décidé de rajouter de la batterie, de la basse, de la contrebasse, un peu de violon. Des petites choses discrètes pour mettre des couleurs. Que ce soit moins plat. Qu’il y ait plus d’identité à chaque morceau.
Et dans la création, est-ce que tu te fixes des limites ? Y’a-t-il des thèmes qui te sont tabous ?
Non. Il me semble que le but d’un artiste, mais aussi d’un être humain, c’est de casser les barrières. S’il y a tabou, c’est que quelque chose cloche.
Il faut casser les murs. Voir si on y va ou on n’y va pas.
Après la création, il y a aussi une partie de « représentation ». La scène. Ton rapport à la scène ? Est-ce un passage obligé pour toi ?
Non, ce n’est pas un passage obligé. C’est un autre métier que de faire des disques. Je me sens plus intime du studio.
La scène, quand ça se passe bien, c’est dément. Quand ça se passe mal, c’est horrible. C’est un exercice excessivement difficile. Dans la mesure où ce que je recherche sur scène, c’est l’abandon. De rentrer dans une espèce de transe. C’est à ce moment-là que je vais pouvoir emmener les gens. Je pense que tu n’emmènes pas un public frontalement. Mais d’abord, en s’emportant soi, puis les musiciens. Et la boucle s’agrandit. Mais c’est très difficile. Ca a dû m’arriver, dix fois en une vie. Et des concerts, j’en ai fait. (Rires)
Toi qui as touché à la fois, à la composition d’albums et de bande originale, que peut faire passer la musique que les images ne peuvent pas forcément ?
Je n’ai pas une grande expérience de la musique de films. Pour le Refuge, le film était assez subtil. Les émotions planquées. La grande difficulté, c’était avant tout de faire en sorte que la musique ne vienne pas piétiner les images. Qu’elle ne vienne pas foutre en l’air la sensibilité et la fragilité du film. Ca, c’était la première difficulté.
La deuxième, c’était plus technique. On avait fait le choix de ne pas avoir recours à un grand orchestre. A des envolées lyriques, ce qui aurait été un peu pompeux. On a donc utilisé des instruments solo. Et là, ça relève beaucoup plus de la performance. Que le musicien soit bon quand il le fait. Et ça, tu ne peux pas vraiment calculer.
Autre danger. Il ne faut pas non plus être trop proche des images. Sinon tu as tendance à tout alourdir. Et justement, François Ozon me demandait d’aller vers quelque chose d’assez éthéré, d’assez léger. En filigrane. Il voulait que j’apporte quelque chose d’autre. Même si ce plus n’a rien à voir. Si par exemple, tu as une envie de courir dans les bois, tu auras ça musicalement. Les images qui raconteront quelque chose et derrière, une autre envie. Et du coup, c’est plus riche.
Une question sûrement totalement tirée par les cheveux, en rapport, cette fois, avec la spiritualité. Dans la plupart de tes albums, celle-ci semble apparaître par à coups. Quelle place tient la spiritualité dans ton œuvre ?
Dans mon œuvre, je ne sais pas. Ma musique, c’est le reflet de ma vie de toute façon. Après, est-ce que je recherche le salut par ce que j’écris ? Mon écriture lâche comme des indices sur moi-même. Mais oui, la spiritualité, je me pose des questions.
Il y a des moments où l’intellect est dépassé. Des notions comme l’exil de l’âme, la chute de l’homme, ça me parle. Je crois en l’accomplissement de l’homme. Que le destin de l’homme, c’est de grandir. De devenir un « dieu » et ensuite, d’être lumière absolue. Je ne crois pas que la vie se résume à la naissance, manger, dormir, boire, faire des enfants, avoir du plaisir et mourir bêtement. Moralement, je trouve ça absurde et c’est tellement fou que je n’y crois pas. La foi, ce n’est pas le mot. Mais c’est quelque chose que je sens au plus profond de moi. Ce n’est pas forcément explicable.
Et puis juste savoir regarder, travailler sur soi. Casser les barrières. Je crois que c’est ça, le vrai travail d’une vie.
Ce qui fatalement, se reflète dans ta musique. De ne pas parler de quotidien, de « médiocre ».
Oui, dans la musique, oui.
Chaque geste est un sous-texte. Le quotidien, c’est une carapace, une ombre. Une enveloppe. Ce qui est intéressant, c’est de regarder ce qu’il y a dessous. Je crois que tout ce qui nous entoure, c’est de la vraie poésie. Il faut juste savoir interpréter ce qui nous arrive.
Pour finir, qu’est ce qu’on peut te souhaiter ? What’s next ?
Plein de projets. D’être heureux. De faire de beaux films et de beaux albums. (Rires). Mais le prochain, je suis curieux de voir ce que ça va donner.
Merci Louis !
Le 21 janvier, vous pourrez le retrouver au Théâtre de Poche de Béthune. Et aussi, dès aujourd’hui, dans les salles dans le film de Mikhaël Hers, Memory Lane.
Louis-Ronan Choisy, Rivière de Plumes, Bonsaï Music/Karamazov Production. Sorti en juin 2010
www.myspace.com/louisronanchoisy
Photos: M. Vandamme, AC Blanchard, myself





![incendies[1]](http://www.arkult.fr/wp-content/uploads/incendies11-150x150.jpg)