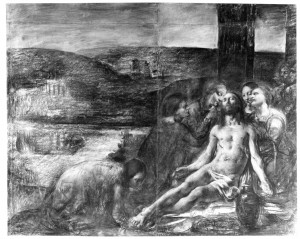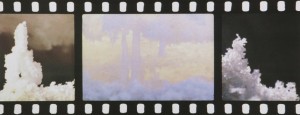« Les Trois Soeurs » : Moscou, mon amour
« Les Trois Sœurs » est l’avant dernière pièce de Tchekhov, écrite en 1900, elle fait partie de ces textes paraissant toujours plus actuels, en résonance folle avec le temps présent. Dans cette pièce admirablement mise en scène par Victoria Sitjà sur le temps, l’amour et l’ennui – en somme la vie – Olga, Macha et Irina se retrouvent avec leur frère Andreï un an après la mort du Père, pour fêter l’anniversaire d’Irina. Fin du deuil, début d’une nouvelle vie ? Elles rêvent toutes de quitter leur demeure provinciale russe pour aller à Moscou, cet ailleurs, ce nulle part : l’autre nom du désir.
Dans un décor relativement dépouillé bien qu’extrêmement évocateur, les treize comédiens ont été dirigés avec dynamisme et une finesse appréciable. C’est autour de trois pans de tissu blanc que les éléments de décor ont été pensés, permettant d’incroyables tableaux vivants sublimés par la lumière et les ombres de ces vies que le théâtre perpétue. En fond de scène, une grande table sert de lieu d’échanges ininterrompus. Face au public, deux malles disposées sur un sol parsemé de livres interpellent par leur teneur symbolique. Posées de part et d’autre de la scène, du début à la fin, les personnages s’y attardent, les trois sœurs s’y asseyent pour fantasmer leur départ. Comme fatalement assises sur leur vie engluée là, dans ce présent qui retient, les remplissant de ces regrets qui alourdissent l’existence. Fuir vers Moscou devient alors le fantasme d’une vie vécue sans les détails, une vie faite d’amours transcendant le présent où l’attente n’existerait plus.
Dans cet espace émerge un jeu d’acteur d’une humanité bouleversante que la création sonore ponctue sobrement. Souvent accompagnés de musiques traditionnelles russes, les comédiens, vêtus tantôt comme au début du XXe, tantôt comme de nos jours, évoluent dans un présent trouble. Dans cet écrin sonore et habillé qui ancre la pièce dans un passé révolu, les personnages viennent pourtant heurter notre présent, celui des émotions d’aujourd’hui et de cette humanité qui ne change pas. Circulant au milieu du public, ils font tomber les frontières temporelles pour un résultat saisissant. C’est notamment le cas de Verchinine, incarné par Alexandre Risso, qui toise le public et philosophe sans retenue. Un pied dans chaque époque, c’est bien à la nôtre qu’il s’adresse lorsqu’il se demande de ce dont on se souviendra. Mais la vie ne change pas, elle est immuable et c’est à Macha, jouée par Ophélie Lehmann, d’une présence scénique effarante, qu’il revient accompagnée de ses sœurs, de vivre pour la vie dont elles ne seront pas. D’une certaine façon, croyant vivre pour un futur meilleur et plus éblouissant, les personnages tchekhoviens ainsi mis en scène nous déchargent nous spectateurs et futur fantasmé, de l’ennui de vivre. Bien présentes sans monopoliser le jeu, les trois sœurs sont renversantes. Olga jouée par Dorothée le Troadec a tout de l’aînée en deuil de sa vie, qui rêve d’un mariage et compile ses regrets dans un flot continu de larmes, elle renonce au départ, finissant comme ses sœurs tout de noir vêtu. Macha, présente même quand elle est absente, occupe les discussions, regrette son existence vide et son mariage ennuyeux. Décharnée, érotisée, alcoolisée, à bout de souffle, elle aime Verchinine le temps d’une danse, d’un baiser, de sa vie passée à s’égarer. Enfin Irina, portée avec beaucoup de fragilité et d’énergie par Mina Castelletta, n’en finit pas d’être touchante et sincère, croyant plus que les autres en Moscou et par extension, en la vie. Si chacun attire le regard par son talent, une phrase prononcée ou un geste esquissé, on pense à Natacha jouée par Elena Sukhanakova qui n’en finit pas de faire rire par ses attitudes détestables, c’est que la vie qu’ils restituent a tout de celle que nous vivons encore. Le jeu temporel marque jusque dans les détails, comme lorsqu’ils se photographient pour ne pas oublier ce moment qui les fixe et les englue. La vie est ainsi faite, à coup de solitude, d’années trop courtes faites de journées trop longues, elle a l’odeur du temps, de la misère de l’amour et de l’attente. À l’image du tableau final, elle passe et s’éprouve en un long soupir.
« Les trois soeurs », de Tchekhov, Cie Les Rivages, mise en scène de Victoria Sitjà, le 9 mai 2016 au Théâtre de Verre, 12, rue Henri Ribière, 75019 Paris. Durée : 2h15. Plus d’informations et réservations sur http://www.theatredeverre.fr/