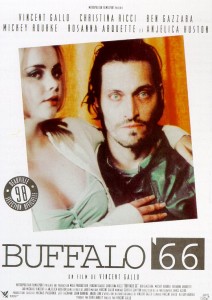L’amour impossible de Felix et Meira
L’histoire d’amour impossible : un thème récurrent au cinéma. De « Autant on emporte le vent » à « Love Story » ; de l’américaine « Titanic » à la française « Pas son genre » ; de la plus classique « Roméo+Juliette » à la plus moderne « Une éducation ». De celle qui se termine bien « N’oublie jamais » à la plus tragique « La princesse de Montpensier » … le genre ne cesse d’être exploité. Mais alors que l’on pourrait croire le sujet épuisé, certains films réussissent encore la prouesse d’apporter un regard original et singulier autour de la rencontre de deux êtres que rien ne prédestinaient à se rencontrer et s’aimer.« Felix et Meira » est l’un d’entre eux.
Félix et Meira c’est l’histoire d’une rencontre improbable, d’une attirance interdite, de deux êtres que le malin hasard décide de rassembler ; au détour d’une ruelle, d’un restaurant, d’un hall d’escalier. Elle, femme juive orthodoxe, mère au foyer prisonnière d’une communauté dont elle ne partage pas les valeurs. Lui, homme indépendant, sentimentalement instable, qui n’a d’autre activité que de dilapider l’argent familial. Meira, jouée par la talentueuse Hadas Yaron (Meilleure interprète féminine à la Mostra de Venise 2012 pour son rôle dans « Le cœur à ses raisons »), n’est pas heureuse dans sa vie de femme au foyer. Elle s’échappe en dessinant des objets, des meubles, dans son petit carnet secret. Mais le dessin, c’est interdit au sein de sa communauté. Comme bien d’autre plaisir de la vie telle que la musique, qu’elle écoute aussi en cachette. Les femmes ne sont à leur place qu’à la maison, à s’occuper des enfants, coiffées d’une immonde perruque brune en carré et toutes vêtues d’une même robe noire. Il leur est interdit de parler aux gens extérieurs à la communauté ou encore de croiser le regard d’autres hommes. Une prison invisible de laquelle Meira cherche doucement à s’extirper et accélérée par sa rencontre avec Félix (Martin Dubreuil).
C’est à travers son deuxième long-métrage, que le réalisateur Maxime Giroux, a choisi de nous conter cette histoire d’amour contemporaine et originale, en dehors des codes des comédies romantiques classiques. Avec douceur et sans trop en faire, il parvient à filmer la passion, l’amour, sans jamais recourir à la facilité. Ainsi, on ne voit jamais les deux amants s’embrasser, c’est tout au plus si ils s’enlacent. L’amour est subtil, suggéré plus que donné en spectacle. Pas de long discours, aux oubliettes les « Ô Roméo! Roméo! pourquoi es-tu Roméo? », place au silence et au jeu de regard.
Maxime Giroux réalise un travail quasi-documentaire, doublé d’une critique acerbe de la communauté juive orthodoxe. Leurs coutumes, leurs habitudes, la condition et la place de la femme … tout y est abordé avec justesse. L’un des acteurs principaux du film, Luzer Twersky, jouant le rôle de Shulem (le mari de Meira) étant lui même un ancien membre de la communauté. Il retrace avec authenticité un quotidien, une philosophie de vie, des valeurs : le sens de la famille, le respect… Et les difficultés auxquelles se heurtent ceux qui veulent s’en détacher. Le départ de la communauté étant irrémédiable et entrainant une rupture totale avec ses amis et le reste de sa famille. Meira emportée par son amour pour Félix, se délivrera peu à peu de sa condition, pour se révéler en tant que Femme. Elle fera l’amusante découverte du pantalon jean qui empêche de respirer, de la danse dans les bars de nuit, de la liberté d’être ce qu’elle est. Chaque minute du film nous réjouit de découvrir un bonheur retrouvé, des joies quotidiennes que l’on fera nous même plus attention à apprécier.
Mais alors que la fin du film nous paraissait déjà tracée, sous fond de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfant », Maxime Giroux y dérègle une nouvelle fois. Achevant son récit, sur un plan des des deux personnages dans une gondole à Venise, sans que l’on puisse réellement savoir ce qu’il adviendra d’eux et de leur amour. Agaçante, frustrante, trop facile diront certain ; je dirai plutôt déroutante ou authentique, à l’image du film. A croire que les histoires d’amours impossibles restent un sujet inépuisable aux mains de talentueux réalisateurs.
« Felix et Meira », de Maxime Giroux, sortie au cinéma le 4 février 2015. Durée, 1h45.