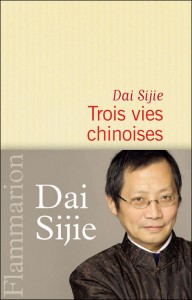On pourrait commencer en bonne ancienne élève de prépa, qui a bien lu son « Qu’est-ce que la littérature ? », et écrit d’interminables bafouilles dessus. On pourrait en rédiger des pages, sur le rapport que tisse l’auteur de HHhH* et Goncourt du premier roman avec la chose littéraire, avec la fiction et la réalité. On pourrait aussi lui demander, en fait. Entretien avec Laurent Binet.
Dans HHhH, vous ouvrez le livre sur l’inutilité du personnage de fiction, en citant Kundera. Et en même temps vous soulignez l’impossibilié de s’attaquer réellement à l’Histoire, de la reproduire. Alors pourquoi et comment écrire ?
En fait, pour que quoi que ce soit entre dans les esprits, il faut le transformer en littérature. C’est vrai que c’était un problème pour moi, sinon un regret. Mais disons que j’ai voulu voir si on pouvait changer ce principe qui fait qu’aujourd’hui, dans la tête des gens, littérature égale roman. Et c’est vrai que la fiction, c ‘est sa spécificité première. Mais le genre a une histoire très longue, qui a beaucoup muté. Du coup j’ai voulu voir si je pouvais raconter cette histoire comme un roman, mais sans recourir à la fiction. Soit en utilisant les outils offerts par le genre, qui ne se limitent pas à l’invention, mais qui permettent les effets de suspense, de style, etc. C’est pour ça que j’ai forgé ce concept d’infra-roman.
Aviez-vous dès le début cette intention de vous prêter au jeu d’esquisser un nouveau genre ?
Oui, c’est un fantasme d’écrivain un peu mégalo, j’imagine, de vouloir inventer. Inventer un nouveau genre ou révolutionner le genre ? Je ne sais pas. Peut-être que mon sentiment s’est infléchi en cours de route. Je crois qu’à la base j’avais une méfiance vis-à-vis du roman, mais des auteurs comme Kundera m’ont fait réfléchir au fait que le genre était assez complexe pour ne pas le cataloguer. On me posait souvent la question au début pourquoi il y avait écrit roman sur la couverture. Je disais que c’était un choix marketing. Mais finalement, je pense que le roman est un genre qui a encore de l’avenir, car il a cette formidable capacité à se renouveler, à se transformer. Du coup ça ne me dérange pas l’idée de me dire que j’ai fait un roman qui a aussi comme intention de renouveler le genre. Et pas un truc qui serait hors roman. J’assume, oui, d’avoir fait un roman !
Reste que vous semblez avoir un rapport complexe à la littérature, entre amour et méfiance…
Disons que pour moi, la littérature est l’arme la plus puissante du monde. Ensuite il faut voir ce qu’on en fait. Ce que je lui reproche, et qui n’est pas forcément de sa faute, c’est d’être sacralisée. C’est-à-dire qu’au nom de la littérature on peut tout se permettre, tout faire. Pour moi ce n’est pas correct. Je suis contre toute forme de sacralisation. La littérature a quelque chose de beau, fort, puissant, mais aussi de dangereux, de plein de mauvaise foi, de défauts. Je ne suis pas déçu par la littérature, mais j’en ai une idée qui n’est pas celle qui est dominante aujourd’hui.
Et l’Histoire, vous la sacralisez ?
Je suis fasciné par le réel. Le fait de savoir que telle histoire est réellement advenue m’impressionne plus qu’une histoire fictive. Qui me plaira pour d’autres raisons. Pour moi l’Histoire est une plusvalue du réel. Même si je pense que, sans être une construction, elle est au moins une reconstruction. Et que la grande Histoire est faite de petites histoires. Sans qu’elle soit une fiction. Je crois vraiment que Heidrich est mort comme ça, même si j’ai pu faire quelques petites erreurs à la marge.
Mais alors comment est-ce qu’on approche l’Histoire quand on est écrivain ?
Je crois que non seulement on a le droit, mais le devoir, de l’approcher. Mais il faut le faire avec circonspection, avec humilité et honnêteté. C’est sûr que c’est un cahier des charges compliqué. D’une manière générale, je ne veux pas parler de l’Histoire comme d’un scénario, comme de quelque chose que j’aurais inventé. En plus dès qu’on touche à la deuxième guerre c’est encore plus sensible.
Quand on vous lit, on a l’impression parfois que vous êtes cet auteur fictif dont parle Borgès et qui essaie de réécrire le Don Quichotte mot à mot, sans y parvenir.
C’est marrant que vous disiez cela, car à un moment dans mon livre, je disais que je me sentais comme un personnage de Borgès, mais cela n’a pas été gardé. Donc en effet, la problématique Pierre Ménard, c’est quelque chose que j’ai vécu ! Avec la peur d’avoir l’impression à la fin de ne pouvoir que recopier des documents historiques.
Pour continuer avec Borgès, il écrit sur Le Livre de sable, qu’il a voulu « conjuguer avec un style simple, parfois presque oral, un argument impossible ». Votre démarche ne se rapproche t-elle pas de cette vision ?
C’est vrai, c’est assez proche de ma conception du naturel. Pour moi le naturel de l’écriture a à voir avec une forme de réalité, relative évidemment. Là encore une fois c’est peut être un goût personnel, mais je pense qu’il vaut mieux éviter trop d’effets de manche, trop d’effusions lyriques, auxquelles je cède dans certains chapitres d’ailleurs. Si vous voulez, ce relâchement était aussi un moyen de conjurer le risque de la grandiloquence dans laquelle on peut facilement tomber avec un sujet pareil.
Le risque de tomber dans la grandiloquence et dans l’effet de réel, que vous dénoncez. Mais en même temps, vous le reproduisez un peu dans votre livre, par votre présence. Vous êtes la caution qui rattache au réel.
Sauf que l’effet de réel c’est inventer un épisode qui a priori ne sert à rien pour donner l’impression que c’est vrai. Dans HhhH, les éléments d’ambiance ne sont pas inventés. Je conçois qu’il y ait des gens qui ne voient pas la différence. Mais pour moi savoir que sur le bureau du président tchèque en exil il y avait un petit speed flyer en étain, ce que j’ai vu en photo, ça m’intéresse beaucoup plus de lire ça, sachant que c’est vrai, plutôt que de lire la même scène, conscient qu’il s’agit uniquement d’un effet. A ce moment-là, je préfère même qu’on n’en parle pas, qu’on me dise juste qu’il est dans son bureau, que je m’imaginerai comme je veux.
Quel rapport avez-vous du coup avec des ouvrages comme ceux de Bukowski, qui mettent en scène un personnage – ici Chinaski – qui est une sorte d’avatar de son auteur ?
Là ça me plaît, parce qu’il y a un jeu, il y a une dimension ludique. C’est la fiction qui joue à plein de sa supériorité sur la réalité, qui est dans le récit de ce qui est fantastiqiue, impossible, de ce qui est irréel. Mais quand elle se contente d’être une pâle copie du réel, ça ne m’intéresse pas. Même si elle peut être tirée jusqu’à la perfection ! Ce que je déteste vraiment c’est le roman réaliste psychologique. C’était intéressant à l’époque, mais il faut arrêter avec ça maintenant.
Est-ce que le rapport entre la réalité et la fiction est un thème que vous souhaitez encore explorer ?
Oui, ce sera du coup la problématique de mon prochain livre. Sauf que là, j’ai eu envie d’aborder ça sous l’angle opposé, celui de la fiction. Ca se passera dans les années 80. Dans HhhH j’ai vraiment essayé d’être transparent, de faire participer le lecteur à mes doutes. Dans mon nouveau roman, il s’agira plus d’un jeu de chat et de souris. Mais pour moi c’est deux traitements différents d’une même question.
Quelque chose qui m’a vraiment intéressé sur ce thème, ça a été le film de Quentin Tarentino, Inglorious Basterd : la première scène est une réécriture de Il était une fois dans l’ouest qui est absolument magistrale. C’est tellement intelligent, notamment parce que ça a ce parti pris de réflexivité : Tarentino s’appuie toujours sur l’histoire du cinéma pour donner sa vision de ce qu’est le cinéma. Ce que j’aime dans le roman moderne – depuis Don Quichotte en gros – c’est que c’est un genre qui passe beaucoup de temps à réfléchir sur lui même, sur ce qu’il est, et à se poser des questions sur son existence. Et ça je trouve que c’est très bien. Cela implique tout une réécriture incessante et une réflexion sur cette réécriture. J’adore ça, parler d’autres films et romans quand moi j’écris une histoire.
Finalement, quand vous réfléchissez à votre travail, à votre démarche, vous vous sentez plutôt écrivant ou écrivain ?
Ecrivant. Socialement, statutairement, j’ai toujours pensé qu’écrivain est un métier comme un autre, même s’il peut être plus cool qu’un autre. On peut se dire écrivain à partir du moment où ça devient notre occupation principale. Mais le problème c’est la mythologie qui est charriée par ce terme, et qui me déplaît globalement. C’est comme la littérature, il y a une sacralisation du statut qui me déplaît. Dans l’art en général. C’est grotesque de dire « Je suis un artiste », je trouve. Le mot écrivain est un peu touché par ce ridicule là. Derrière, on sent qu’il y a une telle posture.
Alors après évidemment, je suis quand même sensible au fait que ce prestige rejaillisse sur moi, c’est flatteur. Mais qu’on en parle franchement. Ce que je déplore, c’est qu’il y a beaucoup de livres qui font semblant de parler d’autre chose, mais qui en fait ne font que ça, viser le « Regardez comme je fais de la littérature ». Quand on attaque Angot, sa réponse est « C’est la littérature qu’on assassine ». Elle s’en sert comme d’une arme à tous les niveaux.
Mais c’est vrai que ce n’est pas toujours facile. Moi qui ai fréquenté simultanément le milieu de l’éducation nationale et de l’édition, je peux vous dire qu’on n’est pas traité pareil, c’est le jour et la nuit ! C’est parfois dur de ne pas devenir complètement mégalo !
*HHhH a été publié chez Grasset. Le livre revient à la fois sur l’histoire de l’opération Anthropoïde, tentative d’assassinat par le gouvernement tchèque en exil du « cerveau d’Himmler », Reinhard Heydrich. Et sur la difficulté de raconter l’Histoire sans se laisser dépasser par la fiction.