Une histoire des illuminations publiques et privées de 1790 à 2016


« Paris entier brille d’une nouvelle illumination (…) et la ville est encore magnifiquement illuminée », cette remarque si actuelle est pourtant du député Cabet, qui en 1845 évoque une fête de 1790. Devenu ordinaire, garanti par la ville, en 2016 à Paris, l’éclairage public ne nous surprend plus sinon pendant les périodes de fêtes, où l’on admire les façades des Grands Magasins et où l’on arpente les Champs-Élysées que l’on ne fréquente pourtant guère le reste de l’année…
Associée à la célébration, l’illumination, d’usage public ou privé, est désormais liée à Noël et plus généralement à décembre sans que l’on ne sache vraiment pourquoi. D’un autre côté, peut-on dater Noël tel que nous le fêtons aujourd’hui ? Alain Cabantous et François Walter dans leur ouvrage Noël : une si longue histoire (2016) esquissent des pistes pour répondre à cette question.
Les débuts de l’électricité
Aujourd’hui devenu rituel obligé, le sapin et les décorations (notamment en Europe et aux Etats-Unis depuis la fin du XIXème siècle), marquent Noël, une fête qui date pourtant de l’antiquité romaine ! Depuis quand ? Le sapin serait entré dans l’espace public dès le XVème siècle, et dans l’espace privé à la fin du XVIIIème. En cette même fin de siècle, Paris devient la « ville-lumière » : le temps de grandes fêtes, des rues entières se parent de décorations lumineuses qui ressemblent davantage aux décorations des siècles à venir qu’à celles du siècle passé, notamment de celles des fêtes royales de Versailles. Avant de parler de Noël, il faut faire un détour par la lumière…

Une gravure d’un dessin d’Armand Parfait Prieur montre par exemple des fêtes et lumières aux Champs-Élysées le 18 juillet 1790, date où le roi Louis XVI prête serment et accepte la Constitution, un jour particulier « où l’on se réunit spontanément au milieu d’une illumination spontanée et générale ».

La fin du XVIIIème siècle, qui correspond aussi à l’arrivée de l’éclairage dans des lieux très fréquentés comme les jardins ou les promenades publiques marque un tournant vers la démocratie. En effet, la lumière adopte des fonctions symboliques particulières : on ne saurait s’intéresser à l’histoire des illuminations de Noël sans évoquer la place que l’éclairage et l’électricité vont progressivement prendre dans les espaces de vie de chacun.
Simone Delattre, dans Les Douze Heures noires : La nuit à Paris au XIXème siècle, explique ainsi que l’éclairage et l’illumination des rues vont aller de pair avec l’idée « de civilisation, de souveraineté, de démocratie, de réjouissance, de luxe, de sécurité, de salubrité, de modernité », alors que l’obscurité est associée à la subversion. Alain Cabantous, à l’origine d’ouvrages sur Noël et l’Histoire de la nuit, mais aussi Daniel Roche dans l’Histoire des choses banales, rappellent que, dès 1763, le royaume de France lance un concours auquel participe notamment Lavoisier, afin de repenser l’éclairage public. Cette initiative donnera naissance au réverbère. Gage de sûreté, la lumière évolue donc rapidement : en 1766, 7000 lanternes à bougies éclairent la ville et dès 1830, 6000 lampadaires au gaz sont installés.
Cette arrivée de l’éclairage dans l’espace urbain est suivie de près par son usage privé. Dès le XVIIIème, un goût plus affirmé de la part des parisiens pour la lumière au sein même de leur logis, et l’éclairage à gaz, « fixe et régulier », va rapidement constituer un premier pas vers les grandes avancées que va connaîtra le XIXème dans l’investissement du lieu privé.

Le glissement se fait sentir lorsqu’on regarde des peintures comme Après le bal, de Jean-François de Troy où, en 1735, la bougie est encore présente dans l’espace privé, face à l’huile sur toile de 1840 de Prosper Lafaye représentant le pianiste Zimmermann dans son intérieur au Square d’Orléans, où la bougie a disparu de l’intérieur, remplacée par un lustre de lampes à huile suspendu au milieu de la pièce.

Car avant la seconde moitié du XIXe, l’utilisation quotidienne de la lumière est encore l’apanage des bourgeois et aristocrates qui illuminent leurs hôtels particuliers, ce qui opère un premier pas entre lieu public et lieu privé puisque l’intérieur est un lieu de représentations sociales.

La lumière est une fête
C’est le quartier de l’Odéon et le Passage des Panoramas qui, en 1830, sont les premiers lieux publics à être éclairés, sortant ainsi la lumière de son luxe. La ville s’embellit et c’est par ce lent contexte d’avènement de la lumière, dont s’emparent et profitent les lieux de commerce, que l’on peut comprendre le goût pour les illuminations au moment de Noël. Pour les boutiques, la lumière est un objet de publicité efficace : elle permet d’attirer le regard, le premier appât commercial ! Elle orne les vitrines et annonce bientôt les devantures des Grands Magasins. Sous le Second Empire, sur l’actuel Boulevard Haussman, s’imposent les fêtes de nuits rendues possibles par la lumière qui leurs sont alors associées.

En 1840, la place de la Concorde et les Champs-Élysées sont embellis, les contre-allées sont enfin éclairées et Victor Mabille, célèbre pour ses bals et le bal qui porte son nom, investit dans près de cinq mille becs de gaz : la lumière devient résolument festive.


L’exposition Internationale d’électricité

Pour autant, Noël et les illuminations n’est pas encore une association évidente avant la fin du XIXème siècle. Il faut attendre l’exposition internationale d’électricité de 1881, soit deux ans après que Thomas Edison a déposé le brevet de l’ampoule électrique, pour que l’électricité devienne un vrai service universel et que celle-ci bénéficie d’un réel tremplin. Lors de l’exposition et la mise en lumière du Palais de l’électricité, plus de 800 000 personnes se pressent pour venir admirer le spectacle, pendant que près de 1000 lampes sont installées par Edison en plein Paris. Inventeur de l’ampoule, en 1880 Thomas Edison mettait au point la guirlande électrique de Noël en 1882. La première guirlande de Noël est commercialisée en 1884, et les illuminations de Noël entrent dans l’histoire pour devenir une tradition. Si la guirlande illuminée se popularise d’abord aux États-Unis, qu’en est-il du sapin ?
Le sapin, cet illuminé

Martin Luther (1483-1546) aurait eu l’idée de décorer un sapin, l’arbre qui symbolise la vie éternelle parce qu’il est toujours vert, avec des bougies. Ce qui symbolisait alors la lumière du Christ avec au sommet, une étoile rappelant l’étoile de Bethléem qui avait conduit les rois mages jusqu’au lieu de la naissance de Jésus. Et avant les bougies, les dictionnaires du XIXème siècle évoquent le fait que l’on décorait les maisons avec des branches, et les sapins avec des bonbons ou des petits jouets pour les enfants.

Ensuite, on raconte qu’en 1738, Marie Leszczynska, mariée à Louis XV, aurait fait installer un sapin à Versailles. Il faut attendre près de 100 ans pour en entendre de nouveau parler : en 1837, la duchesse d’Orléans aurait fait décorer un sapin aux Tuileries. Le conifère le plus connu reste celui du prince Albert et de la reine Victoria qui, en 1841, l’auraient fait dresser au château de Windsor en Angleterre. L’ère victorienne aurait donc marqué un tournant dans l’histoire du sapin de Noël. Encore exceptionnels les sapins, jusqu’en 1880 sont rares ou du moins rarement représentés, et seules des bougies les illuminent.


Mais rapidement, grâce aux avancées électriques et au fait que les bougies deviennent dangereuses (elles sont à l’origine de nombreux accidents) l’Edison’s Illumination Compagny est créée afin de promouvoir l’industrialisation des décorations lumineuses aux Etats-Unis. Une démocratisation encore toute relative jusque dans les années 1920, puisqu’une seule guirlande lumineuse coûtait l’équivalent de 300 dollars, soit 2000 dollars en 2016 !

On comprend que l’un des premiers à acquérir ces guirlandes ait été le président américain Grover Cleveland qui, en 1895, installe le premier sapin de Noël illuminé à la Maison Blanche, avec de surcroît, des éclairages multicolores.


Dans les années 1920, la famille Sadacca décide de créer une entreprise de guirlandes lumineuses et domine le marché jusque dans les années 60. Elle est à l’origine de la vraie popularisation de ces décorations, à un moment où aux Etats-Unis, la tradition du sapin se pérennise à cause du « sapin national », éclairé de près de 3000 petites ampoules.

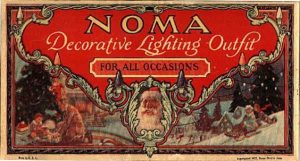


Et la France dans tout ça ?
Du côté français, l’influence américaine retentit en un rien de temps. À l’image des vitrines des magasins Macy’s à New York qui, en 1884, animent pour la première fois leurs vitrines pour Noël et dont la parade de Noël est encore l’un des plus attendues qui soit, les Grands Magasins français s’illuminent à leur tour. En 1883, c’est Le Printemps qui est le premier à être uniquement éclairé à l’électricité. Déjà, en 1860, Émile Zola s’émerveille des vitrines des ces immenses boutiques et de la fée électricité : dans Au Bonheur des Dames il évoque sa « la clarté blanche ».
Puis, les photographies de Léon Gimpel, qui travaille à l’invention de la photographie en couleurs avec les Frères Lumières dès 1904, donnent à voir les illuminations de Noël de Paris des années 1925-1930. Une série de clichés exceptionnelle à plus d’un titre : non seulement les décorations des Grands Magasins (Galeries Lafayettes, BHV Marais, Samaritaine, Le Bon Marché) impressionnent, mais après l’éclairage public et privé, les illuminations de Noël correspondent à nouveau à une avancée technique d’envergure, à savoir ici, l’autochrome !






Face aux Grands Magasins qui profitent des innovations pour se faire de la publicité et attirer le public, les monuments de la capitale ne sont pas en reste, on pense notamment à la Tour Eiffel. Construite en 1889 (en plein essor de l’électricité!) dès son inauguration elle est illuminée par 10 000 becs de gaz. En 1900 elle est ornée de 5000 ampoules, puis en 1978, à l’occasion de Noël, elle est décorée d’un sapin lumineux de 30 000 ampoules !

Paris, comme New York, est alors réputée au moment des fêtes pour ses Grands Magasins. La « ville-lumière », associée au luxe, utilise l’éclaire comme publicité, comme un signe d’opulence et de finesse.

Revenons-en au sapin : en somme, durant l’ère victorienne et pendant tout le XXème siècle jusqu’à nos jours, le sapin et ses illuminations ont investis l’espace public et privé au rythme du progrès électrique. Depuis l’intérieur cossu de la Maison Blanche et de l’Angleterre bourgeoise des années 1880 qui marquent le début d’un Noël commercial, les illuminations sont devenues un temps fort de nombreuses grandes villes.


Le sapin illuminé est devenu un tel symbole de Noël qu’on ne compte plus les photographies des années 40 et de guerre qui montrent des soldats fêtant Noël et parvenant, malgré tout, à se procurer un sapin et bénéficier pour un temps de répit, d’un peu de lumière.

De la même manière, les années 50, le baby boom, les trente glorieuses et l’avènement du capitalisme font monter en flèche les ventes de guirlandes de Noël et autres accessoires de décorations pour les fêtes. Comme en témoignent ces photographies d’époque mettant en scène des familles, on est bien loin des illuminations des premiers Grands Magasins du XIXème siècle, l’effet escompté par le rôle de celles-ci a atteint son paroxysme et les sociétés de vente de décorations font fortune. On ne spécule plus seulement sur le passage du Père Noël la nuit du 24 au 25 décembre. Plus qu’une fête : Noël est un business.


À l’échelle de la capitale française, la tradition s’est bien installée au cours du XXème siècle. Les rues se décorent et des lieux, comme les Champs-Élysées, font l’objet d’innovations perpétuelles pour séduire les parisiens et renouveler l’écrin lumineux des fêtes de fin d’année.



L’engouement est tel que des concours, plus répandus aux Etats-Unis qu’en Europe, sont organisés et font triompher ceux qui auront le mieux, et le plus décoré leur demeure. Certains vont jusqu’à illuminer leur maison pour qu’elle soit vue de l’espace. Il existe même une ville, en Virginie, où Noël est fêté comme au XIXème siècle.
Jusqu’où irons-nous ?





