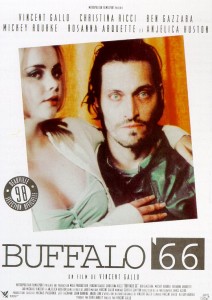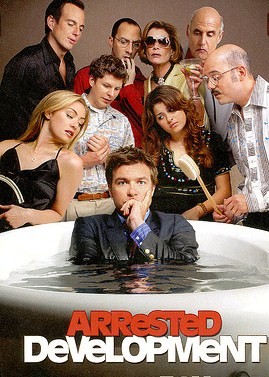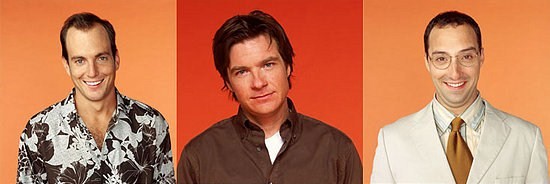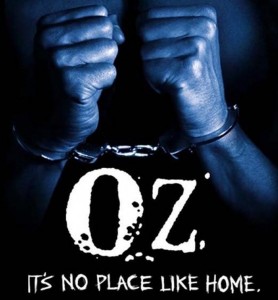A l’annonce de son cancer, Walter White (Bryan Cranston), bon père de famille américain, aurait pu décider d’attendre la faucheuse les arpions en éventail ou bien de boxer les métastases à grand coup de chimio. Tout ça est bien trop ordinaire. Lui, Walter, décrète qu’il va mettre sa famille à l’abri de toute disette future en thésaurisant, sans leur dire, un beau pactole. Toujours est-il qu’avec un salaire de prof de chimie de lycée, sans perspective d’évolutions aucune, peu de risque d’engranger beaucoup de pépètes. Lorsqu’il décide de capitaliser sur la seule chose dans laquelle il est calé et qu’il aime, la chimie, alors là tout bascule. Walter White se lance dans un métier à risque avec des gens peu fréquentables, il devient « cuisiner ».
Mais il ne fait pas la tambouille dans un troquet. Il assaisonne des matières dangereuses pour concocter un plat unique : des méthamphétamines.
Petit effort de visualisation, prenez quelques instants pour vous faire une image mentale d’un alpiniste audacieux pendouillant à une falaise et ne tenant qu’à la force de son petit doigt. Vous l’avez ? Ceci est un « cliffhanger ». Le pendant dans une série est un épisode terminant sur un point crucial de l’action, sans donner de dénouement. Votre héros est donc ce grimpeur qui aurait dû avoir plus froid aux yeux, et dont vous ne connaitrez le sort que dans l’épisode suivant. Dans Breaking Bad, c’est la spirale infernale, on va de cliffhanger en cliffhanger, on se ronge les ongles et on suit chaque épisode sur le qui-vive, les yeux ronds comme des goupilles.
Si vous connaissez déjà la série, lisez sans crainte, pas de « spoilers » dans ce petit billet tout à la gloire de la série de Vince Gilligan.
L’histoire :
Un homme cachant quelque chose à sa femme, ça peut être l’objet d’un bon vaudeville. Mais un homme qui cache quelque chose de notoirement illégal à sa femme, sa famille, ses amis, cela fait une excellente série dramatique. Un Satellite Award, a d’ailleurs consacré Breaking Bad comme la Meilleure série dramatique en 2010.
Walter White (Bryan Cranston) fait le choix de cuisiner des métamphétamines pour laisser un magot coquet à sa femme Skyler (Anna Gunn) et son fils handicapé (RJ Mitte).
« Mais que diable allait-il faire dans cette galère » * ? Walter s’élance dans un guêpier dans lequel sa célérité sera mise à mal et qui partira en cacahouète, à toute berzingue.
La principale source de rebondissements viendra, comme on pouvait le pressentir, des partenaires qu’un tel gagne-pain implique. Le hasard placera sur la route de Walter un de ses anciens élèves : Jesse Pinkman (Aaron Paul). Cancre, rêvasseur et médiocre apprenti chimiste, il est devenu petit trafiquant et producteur de substances illicites. Pinkman a beau avoir basculé du côté obscur il n’a pas l’envergure d’un Pablo Escobar.
Dans ses activités péri-scolaires le Professeur White s’adjoindra les services de ce Jesse Pinkman. Pinkman sera son homme à tout faire et commis de cuisine dans la préparation de cette fameuse drogue synthétique.
Les deux cuistos gagnent du terrain, petit à petit avec leurs rondelettes cargaisons de préparation maison. Les épisodes sont très bien ciselés, chacun d’eux fait avancer l’aventure mais initie et clôture aussi des intrigues courtes. Les épisodes sont oppressants et palpitants. Les coups de théâtres pleuvent sans qu’on ait rien flairé, rien à voir donc avec Master Chef.
Chaque épisode est construit d’une manière originale et troublante. La recette est la suivante : les premiers instants dévoilent de manière extrêmement stylisée et intrigante un élément dans le futur (ou parfois dans le passé) de la série. Il s’agit d’un point hyper focalisé et esthétique, et par conséquent perturbant. Posé en ouverture d’épisode il résonne comme un rébus mystérieux ou une mise en bouche corsée.
Cette pratique n’est pas sans rappeler le système du cliché noir et blanc présentant un élément dans le futur, instauré dans la série NCIS de Donald Paul Bellisario. Celle-ci avait pourtant un but tout autre puisqu’il s’agissait de tenir le téléspectateur en haleine alors que l’épisode était entrecoupé de pages de pub, nombreuses aux Etats-Unis et Canada.
Mais revenons à nos deux gargotiers.
Dans Breaking Bad, le générique enfumé et psychédélico-chimique instaure un rythme lent et pesant au son cadencé de tambours et percussions. Les épisodes qui débutent à sa suite se déroulent toujours sous un œil artistique. Les points de vue sont ceux des deux acteurs principaux mais la caméra passe aussi du côté, si étrange que cela puisse paraître, de leur concoction. Les plans sont brillamment enchaînés et le panel de personnages assure une dynamique décisive dans l’addiction du spectateur.
Au cours de l’épisode, ou parfois dans un épisode suivant, l’énigme introductive trouve son explication et nous laisse volontiers les 4 fers en l’air.

Le ton :
Vince Gilligan reconnu mondialement pour avoir signé et réalisé de nombreux épisodes de « X-Files : Aux Frontières du réel », change ici radicalement de registre et ne conserve que le suspens pour cette série dramatique diffusée par la chaine américaine AMC. Le pitch est aussi simple qu’efficace, on pourrait ainsi sous-titrer la série : Breaking Bad, Où quand un père de famille modèle bascule dans le trafic de drogue.
La première saison est un apéritif savoureux. L’épisode introductif est explosif, il laisse sur le carreau, interloqué. La saison se résumerait ainsi : Si l’effet papillon se définit par des petites causes qui engendrent de grandes conséquence alors à grandes causes… d’autant plus terribles répercussions. La mayonnaise prend bien mais c’est une mise en bouche.
La saison deux se révèle être une entrée bien relevée. Haletante avec une progressive montée en grade de la tension. Les blancs montent en neige et divinement.
La troisième saison un plat de résistance costaud avec une intrigue délicieusement carabinée. Un bon sac de nœuds et de rebondissements.
La quatrième saison : le dessert bien sûr. Mais ça n’est surement pas un petit dessert léger. Il s’agirait d’avantage d’une pièce montée à plusieurs étages qui tiennent en équilibre de façon très précaire… On entre avec cette saison dans une autre dimension : celle des fins gourmets de séries à suspens.
Les 4 saisons disponibles à ce jour, s’inscrivent dans la continuité les unes des autres mais avec une escalade crescendo du suspens et de la complexité de la situation. L’american dream a du plomb dans l’aile, encore une série qui n’est pas tendre avec les United States of America. Les personnages récurrents évoluent, des petits nouveaux viennent se mêler à l’équipe initiale surtout dans la galerie des « bad guys ».
Contrairement à certaines séries qui s’essoufflent au fur et à mesure et qui ont du mal à se renouveler (Desperate Housewives en tête), Breaking Bad ne perd pas le rythme, il n’y a bien que le téléspectateur angoissé qui a du mal à respirer.
Le personnage principal :

Walter White est un personnage ambigu et surprenant. Au fil des épisodes on suit sa transformation physique et psychologique. Viril, pugnace, forcené et à la fois désespéré son comportement ne manquera pas de vous estomaquer.
Bestial, animal ou familial, Bryan Cranston est phénoménal dans Breaking Bad. Aujourd’hui quinqua pêchu, cet acteur américain s’était fait connaître dans un autre rôle de père de famille : celui de Hal dans la série Malcom créée par Linwood Boomer.
Bryan Cranston y était rocambolesque en papa inconscient, dépassé et farfelu.
Il était cocasse en boss raté, acariâtre et autoritariste dans How I met Your Mother.
La critique ne s’y est pas trompée, il triomphe en roi des méthamphétamines. Il a ainsi obtenu trois Emmy Award consécutifs de Meilleur acteur dans une série dramatique en 2008, 2009 et 2010.
Le second rôle :
Apparu dans de très nombreuses séries depuis 1999, la carrière d’Aaron Paul n’a pas vraiment décollé mais il y a fort à parier que son Emmy Award et son Saturn Award de Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique reçus en 2010, changeront la donne.
Aaron Paul est Jesse Pinkman. Partner de Walter White, il est finalement moins à sa place face aux gros durs que son acolyte. L’habit ne fait pas le moine. Cea n’est pas parce qu’il porte un vieux baggy, qu’il est tatoué des quatre membres et qu’il donne des airs à un certain Eminem que c’est un « bad ass », un vrai méchant quoi. Il est purement et simplement candide, inapte et irresponsable. Il s’invente un personnage faussement venu des bas-fonds mai s n’a ni le passé, ni les épaules. En situation de crise, et Dieu sait qu’ils en affronteront de nombreuses, il implose, il déconnecte, il flippe. C’est donc un fardeau, un empêcheur de tourner en rond, un « boulet » extra, un poil à gratter lancinant dans le dos de Walter White. Plutôt lavette que body buildé. Plutôt pommé que méchant.
s n’a ni le passé, ni les épaules. En situation de crise, et Dieu sait qu’ils en affronteront de nombreuses, il implose, il déconnecte, il flippe. C’est donc un fardeau, un empêcheur de tourner en rond, un « boulet » extra, un poil à gratter lancinant dans le dos de Walter White. Plutôt lavette que body buildé. Plutôt pommé que méchant.
Sans le sel apporté par la prestation d’Aaron Paul, l’aventure de Walter White serait, à n’en point douter, fadasse. Walter et Jesse sont deux alpinistes encordés si Walter avance, Jesse aussi, bon gré mal gré. Si Jesse recule Walter aussi. Ils prennent des risques dans leur ascension et le précipice les guette.
Entendons nous bien, d’un côté de la corniche il y a les camés accrocs, les cartels mexicains et la mort. De l’autre : le désaveu de leurs proches, les flics, la prison, la déchéance sociale. A la limite des conventions, nos deux héros ne sont pas au bout de leur peine.
Les rôles secondaires :
Dans la fine équipe de Jesse : Skiny Pete (Charles Baker), Badger (Matt L. Jones) et Combo (Rodney Rush) ne sont pas sans rappeler les pieds nickelés. A eux quatre ils sont la quintessence de la connerie. Cahin, caha ils consomment et/ou vendent les cristaux bleutés.
Dans la famille de Walter, Dean Norris campe un beau-frère assez embarrassant : Hank Schrader. Comme les autres personnages de Vince Gilligan même s’il paraît brut de décoffrage, il est en réalité tout en nuances. Hank c’est « l’homme de la pampa parfois rude mais toujours courtois ». Le rôle et la présence de Hank, s’intensifient au cours des saisons. Il vient perturber la gestion déjà hasardeuse de Walter et Pinkman. A la manière des frères Morgan (Dexter et Debbie) dans la série Dexter, ils ont un sacré conflit d’intérêts dans la famille et cela vient pimenter encore un peu plus le scenario. Fricoter avec la DEA (les stups américains) n’est pas un bon calcul quand on trempe dans le trafic de drogue… c’est s’assurer des tracas à tire la rigot!
Enfin, qui entre dans le monde des affaires aux Etats-Unis aura besoin d’un bon avocat : Saul Goodman (Bob Odenkirk), qui apparaît dès la saison 2, libidineux à souhait, macho et engraissé au pot de vin. Un homme de très mauvais goût entouré d’enfants de cœur adorables, tueurs à gages et autres hommes de mains, tel que l’imperturbable Mike (Jonathan Banks).
Petit clin d’œil au personnage fétiche de Robert Rodríguez : Machete joué par Danny Trejo aussi connu sous les noms tranchants de Razor Charlie, Cuchillo (couteau en espagnol) ou Navajas (lames). L’acteur américain fait une apparition, courte mais sensationnelle dans la Saison 3, dans la peau d’un trafiquant mexicain du nom de Tortuga. Toujours à l’aise dans ses santiags l’amigo!
Dans le but de ne pas trop vous en dire, tous les personnages ne sont pas ici décrits mais les fans de la série s’accordent sur le fait que la prestation de Giancarlo Esposito est troublante et pimentée dans le rôle d’un personnage un peu trop propre sur lui le gérant des fast-food « Los Pollos Hermanos ».
Est-il vraiment nécessaire d’ajouter quelque chose pour vous donner envie de gouter à Breaking Bad ?
Pour le fun :
Voici en prime trois vrai-faux sites web vu dans la série.
Liés aux événements de la Saison 2 :
– le site créé par Walter Junior pour lever des fonds pour son père http://www.savewalterwhite.com/
– le site de Saul Goodman l’avocat véreux au slogan entêtant « Better call Saul » http://www.bettercallsaul.com/
Liés aux événements de la Saison 3 et 4 :
– le site de la chaîne de resto de poulet fris de Gustavo Fring http://lospolloshermanos.jimdo.com/
Casting :
Bryan Cranston (Walter White), Aaron Paul (Jesse Pinkman), Dean Norris (Hank Schrader), Betsy Brandt (Marie Schrader), Anna Gunn (Skyler White), RJ Mitte (Walter White Junior), Bob Odenkirk (Saul Goodman), Giancarlo Esposito (Gustavo Fring), Charles Baker (Skiny Pete), Matt L. Jones (Badger), Rodney Rush (Combo) …
Note :
* Les Fourberies de Scapin, Molière.
 Les toutous et les journalistes peuvent au sens de Paul Nizan être des « chiens de garde » (1).
Les toutous et les journalistes peuvent au sens de Paul Nizan être des « chiens de garde » (1).